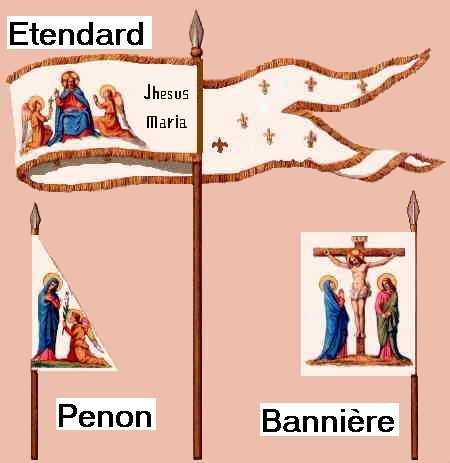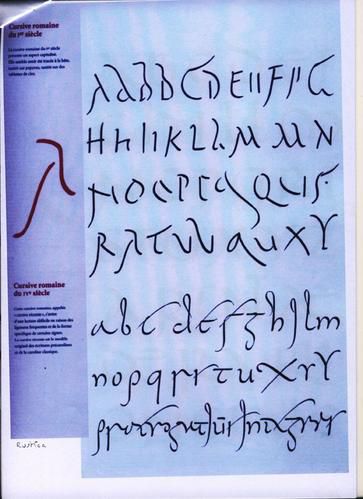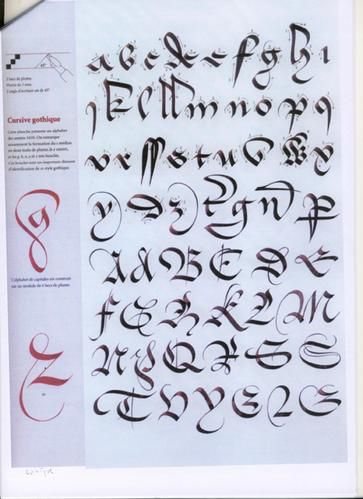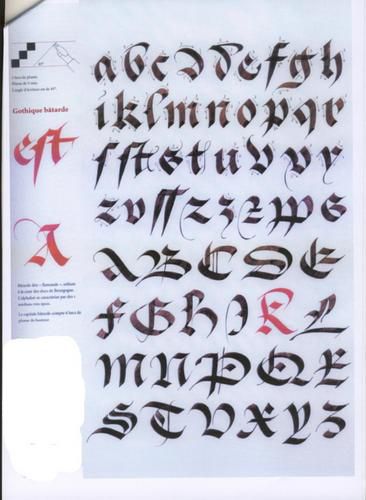Un ardent défenseur des droits des prisonniers avait un jour qualifié de moyenâgeux notre système carcéral. Avait-il raison ? Il sera en mesure d'en juger un peu plus objectivement après les considérations qui vont suivre sur les prisons des derniers siècles du Moyen Âge.
Il existe alors deux sortes de prisons : la prison « fermée » et la prison « ouverte ». La prison « fermée » correspond à ce que nous appelons prison, sans qualificatif, ou incarcération ; la prison « ouverte » n'est pas, à nos yeux, une prison, car ses murs coïncident avec les murs d'une ville, les frontières d'un duché ou d'un royaume. Certains auteurs qualifient de « courtois » l'emprisonnement en prison « ouverte ». De nos jours, quand la justice demande à une personne de ne pas quitter le pays, personne ne dit qu'elle est en prison.
On pratiquait l'emprisonnement préventif, en prison « fermée » ou en prison « ouverte ». Préventif, dérivé de prévenir, au sens où l'on prévient une maladie, c'est-à-dire qu’on l'empêche d'éclore. Par l'emprisonnement préventif, on voulait s'assurer que l'accusé ne fuie pas ; qu'il soit disponible à l'ouverture de son procès ; qu'il attende le prononcé du jugement ou l'exécution de la sentence. S'il s'agit d'un criminel condamné à mort, il serait imprudent de le laisser en prison « courtoise » en attendant que le bourreau le pende ou lui tranche la tête. L’emprisonnement préventif en prison « fermée » était réservé aux grands criminels, peu nombreux. La grande majorité des accusés étaient en prison « ouverte ».
On témoigne d'une préférence marquée pour la prison « ouverte » ; quant à la prison « fermée », elle suscite une répugnance générale, et l'on cherche des moyens d'y soustraire même les grands criminels. Le responsable de la prison est tenu de veiller à ce que les auteurs d'infractions légères ne demeurent pas incarcérés. Souvent, il s'agit de pauvres diables qui n'ont pas trouvé de caution.
Étant donné ces principes et cette mentalité, la plupart des prisonniers du Moyen Âge sont en prison « ouverte », tenus seulement de se présenter devant le juge au jour fixé. À nos yeux, ce sont des prisonniers en liberté. Dans les prisons « fermées », on trouve quelques grands criminels, de pauvres diables sans caution et des vagabonds. Souvent, la détention préventive se prolonge, et le roi se sent obligé d'intervenir pour que les responsables de la justice se hâtent de rendre leur jugement.
Nous trouvons normal l'emprisonnement préventif de l'accusé, en prison « fermée » ou en prison « ouverte ». Mais, tenez-vous bien, le Moyen Âge emprisonnait parfois l'accusateur avec l'accusé... Étrange coutume, direz-vous. Pas bête, au fond, quand on en connaît les motifs. On voulait par là diminuer le nombre des accusations sans fondement ou fondées sur des motifs inadmissibles. Si, en accusant autrui, on risque de prendre soi-même le chemin de la prison, on réfléchit avant d'accuser. Dans ce cas également, l'emprisonnement s'effectue en prison « fermée » ou en prison « ouverte », mais c'est le même genre d'emprisonnement pour l'accusateur et pour l'accusé : il n'y en pas un en prison « fermée » et l'autre en prison « ouverte ». Si le crime est grave, c'est la prison « fermée » pour les deux.
En emprisonnant ainsi l'accusateur avec l'accusé, on s'assurait de la disponibilité du premier : un accusateur de mauvaise foi aurait pu prendre la fuite et entraîner de longues et coûteuses recherches. De plus, il y avait des sanctions, surtout pécuniaires, contre l'accusateur convaincu du caractère erroné de son accusation : dédommagement de l'accusé ; amende pour l'ennui causé à la société ; paiement des dépens du procès. Enfin, la peine encourue par l'accusé risquait d’être prononcée contre l'accusateur. Par exemple, si l'accusé était acquitté d'un crime qui méritait — supposons-le — l'amputation d'une oreille, l'accusé risquait d'en perdre une... Cependant, la plus grande indulgence régnait de ce côté-là.
Quand un accusateur et un accusé prennent ensemble le chemin de la prison, ils peuvent ensuite bénéficier d'un élargissement sous caution, passer de la prison « fermée » à la prison « ouverte ». Mais la règle du maintien de l'égalité exige que les deux soient traités de la même manière. La bonne réputation morale de l'une des parties peut tenir lieu de caution. Parfois, on confie à des personnes fiables les deux prisonniers. Enfin, dans certains cas, ce sont les amis qui veillent sur le prévenu incapable de fournir une caution.
Bref, la prison « ouverte » constitue, sans le moindre doute, le mode d'emprisonnement préféré au Moyen Âge. C'est la règle, alors que l'incarcération est l'exception. Dans le cas des petites infractions, le prévenu est immédiatement mis en prison ouverte ; dans le cas des infractions graves, il est d'abord incarcéré, puis remis, sous caution, en liberté limitée : limitée à une ville, à une ville et sa banlieue, à une province, à un royaume, au jour et non à la nuit, à quelques jours de la semaine. Parfois, on autorise le prévenu à se rendre où il veut — jusqu'au bout du monde —, à condition de rester disponible pour une convocation de la cour, ce qui constitue une sérieuse contrainte à une époque où le cheval est le moyen de transport le plus rapide.
L’emprisonnement préventif prend normalement fin après une sentence qui acquitte l'innocent ou condamne le coupable ; il prend fin également quand le prisonnier s'évade. Mais, s'il a été imposé comme une peine pour l'infraction, l'emprisonnement se poursuit. Il change alors de nature : de préventif qu'il était, il devient pénal. Ce genre d'emprisonnement n’a pas occupé au Moyen Âge la place prépondérante qu'il occupe maintenant, mais il a été pratiqué, et il était toujours une incarcération, c'est-à-dire un séjour dans une prison fermée. Aucun juge n'imposait comme sentence à l'auteur d'une infraction de ne pas quitter la ville pendant un mois.
L’incarcération pouvait être imposée comme peine principale, comme peine complémentaire ou comme peine de remplacement. Comme peine principale, l'incarcération punit les auteurs d'infractions légères. Un mal engueulé de Senlis, qui avait proféré un blasphème, fut condamné à un mois de prison au pain et à l'eau. Et le roi Charles VI émet, en mai 1397, une ordonnance à l'encontre des blasphémateurs pour qu'ils « soient corrigés et punis par détention de leurs personnes en prison fermée ». L’incarcération est rarement infligée aux auteurs d'infractions graves, mais on en trouve des cas. Par exemple, le meurtrier d'un avocat avait été condamné, en 1341, à la prison perpétuelle.
D'ordinaire, l'incarcération s'ajoute à une autre peine : peine corporelle comme la fustigation — du latin fustis, bâton ; peine pécuniaire, dans la majorité des cas ; peine professionnelle : interdiction d'exercer une profession ; bannissement, parade pieds nus, amende honorable à la victime. Parfois, la peine infligée est triple : incarcération, amende et châtiment corporel. Le Canada n'a pas connu tout l'éventail des peines corporelles infligées au Moyen Âge, mais il a connu le fouet que, pour certains crimes, on ajoutait à l'incarcération.
Enfin, l'incarcération est imposée comme peine de remplacement dans les cas où les contrevenants sont trop pauvres pour payer l'amende. L’obligation d'en arriver là déplaisait souverainement aux justiciers du Moyen Âge : au manque à gagner — l'amende non payée — s'ajoutaient les dépenses occasionnées par l'entretien d'un prisonnier incapable de défrayer le coût de son séjour en prison. Vous sursautez avec raison ; nous y reviendrons.
Après avoir parlé de l'emprisonnement préventif et de l'emprisonnement pénal, un mot de l'emprisonnement « coercitif ». Les deux premières formes d'emprisonnement se pratiquent toujours ; la troisième n'est plus qu'un souvenir. L’adjectif coercitif vient du latin coercere, contraindre. Si, par exemple, un contrevenant solvable refusait de payer l'amende imposée par le tribunal, on l'emprisonnait pour l'y contraindre. L’incarcération ne remplaçait pas le paiement de l'amende : elle avait pour but de le provoquer. Comme le prévenu défrayait déjà le coût de son séjour en prison, le refus de payer une amende coûtait cher. De plus, la vie dans les prisons faisait plier les volontés les mieux trempées. Allons y faire un tour.
Les prisons du Moyen Âge ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Pendant la féodalité, le pouvoir judiciaire est éparpillé. Beaucoup de gens exercent la justice : seigneurs, évêques, abbés, rois. Chacun de ces justiciers a sa prison, et ce n'est pas le « fédéral » qui l'a construite. Peu soucieux des « droits » de la clientèle qui va s'y retrouver, c'est avec parcimonie qu'on investit dans ces HLM. De plus, la surveillance laisse beaucoup à désirer, car personne ne recherche cet emploi, occupé, d'ordinaire, par des hommes qui n'ont reçu aucune formation.
Pour prévenir les évasions faciles, on enchaîne les prisonniers par les jambes, les bras, parfois le cou. De plus, on prévoit de sévères peines pour le bris d'emprisonnement, perpétré avec ou sans effraction. Si l'emprisonnement est une simple assignation à résidence — prison ouverte —, l'effraction est impossible. Le prévenu en prison ouverte qui manque à sa parole est tout simplement incarcéré. Quant au prévenu incarcéré, il peut difficilement s'évader sans effraction, ne serait-ce que le bris de sa chaîne. Son évasion est alors considérée comme une présomption de culpabilité et un aveu. Si on parvient à lui mettre la main au collet, il est condamné à la peine du crime dont il était accusé.
Mais, pour le condamner, il faut le rattraper. Et il existe un privilège qui a nom « droit d'asile ». Ce petit mot, asile, est formé de deux racines grecques : un « a » privatif et « sulê », arrêt, saisie. Le droit d'asile, c'est la possibilité d'échapper à la justice en se réfugiant dans des endroits où il est interdit à la police d'accéder pour appréhender même un criminel. Un condamné à mort qui franchit la clôture du monastère le plus proche peut y finir ses jours en toute sécurité ou le quitter quand on l'aura oublié, s'il n'a pas développé de goût pour la vie monastique...
Source : « Sacré Moyen âge » de Martin Blais.