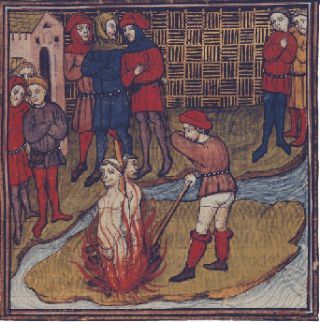Lien entre Justice et
Royauté.
L'exercice de la justice dans les
royaumes de France et d'Angleterre, entre la fin du XIIème siècle jusqu'au milieu du XVème.
Quel est le lien entre justice et royauté?
Comment la justice est-elle rendue en temps de guerre (pendant la Guerre de Cent ans notamment)?
Pour "Justice et Royauté", faut-t-il traiter de la justice royale exclusivement ou bien parler de la justice en generale (justice seigneuriale,...)?
Au début de la monarchie capétienne, le pouvoir de la justice royale est très faible et s'affirmera au fur et à mesure que la puissance royale s'accroit. D'ailleurs, le droit de faire appel
à la justice du Roi, sommet de la pyramide seigneuriale, est un des moyens usuels de la monarchie pour affaiblir le pouvoir seigneurial.
L'immixion de la justice royale commence dès Louis VII, voire même, timidement, sous Louis VI. Philippe-Auguste la développe beaucoup et s'en sert contre les seigneurs provinciaux. Elle est donc
déjà bien installée lors du règne de Saint Louis.
Le roi législateur
Le rôle essentiel du roi de France est
d'être le grand justicier. Mais la justice terrestre est l'application de la loi, et il délicat de savoir dans quelle mesure le roi de France au Moyen âge a ce que nous appellerions aujourd'hui
le pouvoir législatif.
On ne saisit aucune disposition
législative d'un caractère général pour le royaume et émanant du roi aux XIe et XIIe siècles. Les deux premières ordonnances que l'on connaisse datent du règne de Louis VII. En 1144, le roi
bannit les Juifs relaps du royaume. En 1155, à Soissons, il établit la paix de Dieu pour 10 ans. Mais cette dernière ordonnance est plutôt la manifestation d'un élan de piété plutôt qu'une
disposition émanant de la volonté royale.
Sous Philippe Auguste, le nombre et
l'importance des ordonnances augmentent. On peut citer l'ordonnance de 1190 sur l'administration du royaume pendant la croisade du roi (connue sous le nom trompeur de Testament de Philippe
Auguste), mais aussi l'ordonnance sur la succession des fiefs en 1209 ou 1210 (décidant que lorsqu'un vassal meurt en laissant plusieurs fils, tous relèveront désormais directement du roi et non
plus de leur seul frère aîné, comme c'était le cas auparavant), l'ordonnance rendue vers 1214, portant à la moitié la part d'usufruit légal de la veuve sur les "propres" de son mari. Mais il faut
remarquer que ces deux dernières ordonnances sont limitées au seul domaine royal.
De plus, le roi n'a pas le monopole de
la législation, ni au cours de cette période, ni même de la suivante. Nous connaissons une série d'ordonnances rendues par des grands feudataires, mais dans l'ensemble, cette législation est
rare, et les ordonnances demeurent globalement peu nombreuses.
Au cours du XIIIe siècle, le roi tend
à imposer sa législation, non seulement aux gens de son domaine, mais aussi dans certains cas et pour des objets déterminés, à l'ensemble de ses sujets.
Notons que l'ordonnance n'obligeait,
semble-t-il, que ceux des grands ayant assisté à son élaboration, même s'ils n'avaient pas approuvé. Il est toutefois probable que ceux qui n'avaient pas assisté à l'assemblée étaient moralement
tenus de l'observer et de la laisser courir chez eux. Mais tout dépendait donc de la bonne volonté des feudataires, ou de la force du roi, c'est-à-dire des circonstances.
C'est sous le règne de Saint Louis que
l'on voit la royauté manifester de plus en plus une autorité législative. Bien sûr, tout ce qui est appelé ordonnance n'a pas forcément un caractère législatif d'intérêt général. Il n'est pas
toujours possible non plus de savoir si ces ordonnances étaient applicables à tout le royaume ou seulement au domaine du roi. De plus, beaucoup d'ordonnances ont un caractère religieux ou
ecclésiastiques (comme par exemple les ordonnances contre les blasphémateurs ou celles sur la réformation des moeurs légères ou du costume).
Quoi qu'il en soit, à l'époque ou
Saint Louis légifère, un courant d'idées se développe tendant à restituer à la puissance royale le droit de légiférer. Le pouvoir de faire des lois, dit saint Thomas d'Aquin, appartient à celui
qui représente la multitude.
Il est probable aussi que la réunion à
la Couronne des provinces du Midi a eu son influence aussi. Si le droit romain n'avait qu'une valeur de coutume dans le Midi, le XIIe siècle avait vu la renaissance du droit romain en Italie et
cette renaissance n'avait pas manquer de redonner une vie nouvelle au droit archaïque du Bréviaire d'Alaric (un abrégé du code Théodosien, rédigé en 506 sur l'ordre d'Alaric II). Cette
renaissance du droit romain avait surtout pour conséquence de rappeler l'ancienne puissance du prince, et, par contrecoup, de rehausser le pouvoir du souverain du royaume de France. Pour ces
raisons, sous le règne de Philippe III le Hardi, fils de Saint Louis, l'activité législative de la Couronne est particulièrement considérable.
Il ne faut toutefois pas se faire
d'illusions. Une bonne partie de la législation de Philippe III est une réédition de mesures prises déjà par son prédécesseur, dont il avait, dès le 2 octobre 1270, au lendemain de son avènement,
confirmé en bloc, par son testament, tous les établissements. Cette mesure prise par Philippe III montre que, si la royauté légifère, les actes législatifs qu'elle publie n'engagent normalement
qu'une portée limitée, dan sle temps, au règne du souverain qui en est l'auteur et non pas une autorité sans limite chronologique.
La matière des établissements de
Philippe III est souvent d'ordre administratif, mais il a cependant légiféré de manière originale, sur plusieurs points de droit public : c'est lui qui a fixé à 14 ans révolus la majorité du fils
du roi, en décembre 1271. Il a également exigé, dans tout son royaume des droits d'amortissement sur les terres contenues dans les fiefs ou arrière-fiefs royaux.
Comment s'exerce ce pouvoir législatif
du roi ? Il s'exerce par la publication de ces ordonnances (ou établissements), mais le prince n'est pas investi de la puissance de rendre ces établissements généraux, avec licence d'en user et
d'en abuser à son gré, comme auraient pu le faire des empereurs romains. Le mode d'exercice et l'étendue de cette puissance sont fixés par la doctrine féodale. Le roi peut promulguer deux sortes
d'établissements : comme tout baron, dans son domaine propre, et à titre de roi, pour la France entière (on parle alors d'établissements généraux). Ces derniers, faits à toujours ou à terme,
doivent être observés partout, sous peine d'amende.
Un établissement général doit vérifier
les conditions suivantes : qu'il ne griève pas as choses qui sont fetes du tans passé, ne as choses qui aviennent dusqu'a tant que li establissemens est commandes a
tenir qu'il soit délibéré par très grant conseil qu'il soit fait pour le commun profit du royaume et pour cause raisonnable.
Il faut toutefois noter que cette
législation royale mettra fort longtemps à être strictement appliquée. Pour preuve, l'interminable répétition des ordonnances sur le même sujet. Cette répétition prouve que la royauté tenait à
voir, sur certains points, sa volonté exécutée, mais elle montre aussi que cette dernière ne l'était pas. Très rapidement aussi, pour les souverains français, les actes de leurs prédécesseurs
sont considérés avec le même respect que la coutume, c'est le mos majorum de la monarchie française.
Mais tout ceci ne s'applique qu'au
droit public. Le droit privé n'a pas été touché par la royauté. Le souverain n'intervient dans ce domaine qu'en faisant rédiger des coutumes locales. Il les transforme ainsi en établissements
royaux, mais sans oser fondre cet ensemble énorme et disparate. Philippe III avait par exemple fait mettre par écrit la coutume de Toulouse, mais le travail de rédaction d'ensemble ne commença
qu'à la suite de l'ordonnance de Montils-les-Tours, en avril 1454. L'oeuvre ne fut d'ailleurs achevée que sous François Ier et Henri II.
Le pouvoir législatif est donc revenu
aux mains du roi, et il peut l'exercer presque sans contrôle, puisque le Conseil qu'il a autour de lui est désigné par lui, et peut être modifié par lui aussi. Mais dans l'exercice du pouvoir,
les rois ont longtemps été gênés par de vieilles habitudes de respect pour le passé, et aussi par le respect supersicieux d ela coutume, qui leur interdisait toute incursion dans le domaine du
droit privé.
En fait, l'homme médiéval était
incapable de comprendre un mécanisme législatif ayant pour but de créer ou d'abroger les lois "à jet continu" : il se faisait de la loi un idéal qui la représentait comme un dépôt très précieux
de la sagesse des ancêtres, qu'ils avaient le devoir de transmettre intact à la postérité. Le souverain pouvoir leur paraissait donc institué, non pour changer la loi, mais pour en assurer le
respect.
La justice que rend le roiest donc
rendue conformément à la coutume, héritée des ancêtres et sur laquelle le roi ne peut ni ne veut agir. Mais comme mentionné, cette coutume a diverses formes selon les lieux où elle s'est formée.
Quelle sera donc la coutume qui servira aux sentences du tribunal royal ? Ce sera naturellement celle de la ville ou réside le roi et sa Cour, Paris. C'est donc la coutume de Paris qu'appliquera,
dans la plupart des cas, la Cour du roi, agissant en temps que tribunal, la curia regis in parlamento, ce qui deviendra le Parlement.
Le roi justicier
Le roi et sa cour n'ont que lentement
regagné le terrain perdu par la royauté dans le domaine judiciaire. En théorie, tous les sujets directs du roi sont justiciables de la Cour : ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine, comme
les comtes de Flandre, de Champagne, d'Anjou, comme le plus simple vassal. Dans la pratique, la compétence de la curia regis, la reconnaissance de son autorité suprême sur les grands feudataires
n'a pu s'imposer que par la force, à la suite de luttes longues et dures.
Procédons par étapes, voyons qui est
jugé et quelles causes sont portées au tribunal du roi.
Dans la majorité des cas, ce sont des
plaines d'ecclésiastiques, évêques, abbés, contre des seigneurs voisins et contre des avoués, soi-disant tenus de les protéger, et trop souvent devenus des oppresseurs. Le tribunal est aussi
saisi de différends entre ecclésiastiques de monastère à monastère, d'évêque à chapitre...).
En ce qui concerne le monde laïc, la
Cour connaît des affaires criminelles (assassinat de Hugues de Beauvais par le comte d'Anjou Foulque Nerra par exemple). Elle juge aussi des infractions au droit féodal (Aimon et Archembeaud,
sous Louis VI, se disputent la seigneurie de Bourbon, par exemple).
Dans ses différends avec ses
feudataires, le souverain s'en remet aussi à sa Cour pour trancher la querelle. Par exemple, en 1152, Henri II duc de Normandie est condamné pour avoir épousé Aliénor d'Aquitaine, femme répudiée
du roi Louis VII.
Enfin, à partir de la fin du rène de
Louis VI et de celui de Louis VII, des différends d'un caractère nouveau sont portés à la Cour du roi, ceux des communes. Les évêques de Soissons, de Beauvais, de Laon, de Noyon, etc. ne cessent
de se plaindre des empiètements de ces associations jurées que sont les communes, constituées de gré ou de force dans les cités épiscopales.
La juridiction d'appel qui, à partir
de la fin du règne de saint Louis, transformera le rôle judiciaire de la Cour et aboutira à l'organisation d'un corps spécialisé, n'offre qu'un très petit nombre d'exemples pendant cette période
archaïque de la juridiction royale. Par exemple, citons un cas en 1132 où la Cour réforme une sentence de l'évêque d'Arras contre un chevalier.
L'activité judiciaire de la Cour tend
à se développer à partir du règne de Louis VII, en dépit des résistances des grands et du clergé. La résitance ces grands va de soi.
Le monde féodal, par essence anarchique, répugne à tout ce qui peut donner de la stabilité à la société. L'arrêt tombant comme un couperet sur la tête de l'accusé l'effraie et l'indigne. Il
convient de n'être pas trop dur, même pour une culpabilité avouée, il ne faut pas blesser l'honneur d'un noble, et pour cela, la condamnation doit revêtir l'aspect d'une transaction.
Le clergé lui-même est souvent récalcitrant. Alors qu'il ne cesse d'implorer le roi, et de réclamer son intervention quand ses intérêts sont menacés, il n'admet pas qu ele roi s'inquiète des abus
qu'il peut commettre. Dans ce cas, les évêques, particulièrement, tentent d'esquiver la compétence de la Cour. Néanmoins, dans le royaume de France, le conflit ne prendra pas le caractère
tragique de la lutte de l'archevêque de Canterbury, Thomas becket, et du roi d'Angleterre, Henri II. Le clergé de France avait-il plus de bon sens ? Peut-être, mais il avait surtout trop besoin
du roi contre les empiètements et les violences du monde laïque, plus graves en France que de l'autre côté de la Manche.
Néanmoins, en dépit des mauvaises
volontés, des résistances violentes et sournoises, on assiste à un courant d'affaires sans cesse accru, portées à la Cour, et cela sous le règne d'un roi faible, Louis VII. Il ne faut pas y voir
de paradoxe. Le roi est faible, certes, mais dans la seconde partie de son règne, il est presqu'un saint, préfigurant ainsi son arrière petit-fils. Le désir ardent des hommes, de tout pays et de
tout temps, d'obtenir justice a du contribuer à soutenir ce sourant d'affaires portées à une cour présidée par un roi si pieux. Car n'oublions pas que le roi préside en personne le tribunal
jusqu'à la fin de cette période.
Toutefois, ce courant n'enflera qu'au
siècle suivant, grossi d'affluents venus de tous les coins du royaume pour aboutir à Paris, dans ce palais du roi qui est déjà presque un palais de justice. L'absence du souverain, de plus en
plus fréquente, est le signe que le nombre des affaires se multiplie, et elles prendraient donc trop de son temps, employé à d'autres besognes.
Les textes appellent la Cour du roi,
fonctionnant comme tribunal placitum (comme à l'époque franque), audientia, et surtout curia, jamais alors parlamentum.
La Cour du roi est ambulante, comme lui, mais elle ne se tient plus à ce siècle que dans l'étroite partie du royaume où le roi peut circuler sans danger, souvent dans les abbayes royales. A
partir du règne de Louis VI, le roi à tendance à se tenir à Paris pendant la majeure partie de l'année. Les causes sont donc jugées à Paris, mais il s'agit d'une habitude, et non d'une règle.
Aucun principe ne fixe l'époque de sa convocation. En fait, elle se tient presque toujours lors des grandes fêtes ecclésiastiques de l'année (Purification, Pâques, Pentecôte, Toussaint).
Sa composition est variable, indéterminée. La Cour de justice, qui se confond encore avec l'assemblée politique, est formée de l'entourage du roi, des gens de son hôtel, de ses conseillers
favoris, d'habitués, chevaliers et clercs, enfin de grands feudataires, généralement ne petit nombre. Chose déconcertante, la composition de cette Cour ne semble pas varier d'après la qualité des
accusés ou des plaignants. La présidence de la Cour appartient au roi jusqu'à la fin du règne de Louis VII. Ensuite, la précence du souverain se fait de plus en plus rare, mais bien que rendue
hors de sa présence, la sentence est et demeurera rendue en son nom.
La Cour préfère l'arbitrage, la
conciliation, à l'arrêt. C'est que, conformément au passé, le condamné doit accepter sa sentence, s'engager à l'exécuter. S'il refuse, il a le droit de quitter la place sans être inquiété et, si
c'est un grand personnage, un conflir armé est à redouter. La Cour s'applique donc à concilier les parties.
L'apparition d'un corps spécialisé de
juges est le trait le plus nouveau du régime judiciaire sous Louis VII. C'est que l'écrit et le témoignage oral ont tendance à reprendre de l'importance au détriment du duel judiciaire qui a
cependant la vie dure. Or, les grands n'ont ni la compétence, ni le temps, ni le goût, de se livrer à des enquêtes, d'instruire des affaires. Ces besognes fastidieuses incombent au personnel
composé en grande partie de clercs, sous les ordres du chancelier. Cependant, c'est à la Cour dans son ensemble de se prononcer. La tâche des nobles se trouve simplifiée : la partie fastidieuse
d'une affaire leur a été épargnée, ils n'ont plus qu'à se prononcer.
Là est le germe fécond. Ces obscurs professionnels sont les ancêtres des juges du Parlement de Paris. Sous le règne de Louis VII, ils sont cités sous diverses dénominations : hommes sages (viri
sapientes), prud'hommes (viri prudentes), jurispreudents (juriprudentes), conseillers (consiliarii), nos juges (judices nostri).
La physionomie de la Cour ne change
pas sensiblement sous les règnes de Philippe Auguste, de Louis VIII, et pendant la première partie du règne de Louis IX. La Cour se scinde de plus en plus en deux parties, ou prend deux aspects.
Comme par le passé, on y voit de grands personnages (évêques, abbés, comtes, ou barons). Ils sont réunis le plus souvent aux quatre grandes fêtes de l'année. Mais, dans l'entourage du souverain,
on distingue une partie permanente, en tant qu'organe judiciaire, dont les représentants sont qualifiés de maîtres (magistri curiae). Les sentences sont néanmoins toujours rendues par la Cour
entière et au nom du roi.
Cette période archaïque
se prolonge jusqe vers le milieu du XIIIe siècle. C'est le développement de l'appel qui y mettra fin.
Quelle part de l'activité judiciaire et quelle "influence" a la justice écclésiastique dans le royaume ? S'en remet-on systématiquement au roi ? Il n'y a pas également des cours de justice
écclésiastique qui rendent la justice (pour des affaires moindres, certainement) ? Et puis, lorsqu'il y a différend entre évêque et évêque, institution écclésiastique(surtout séculière) contre
institution écclésiastique, ce n'est pas la justice de l'évêque de Rome qui est censé trancher ? En d'autres termes, pourquoi les hauts dignitaires de l'Eglise (de Rome, et pas de France ! au
début du XIIIème siècle l'Eglise triomphe avec un pape comme Innocent III, le gallicanisme ne commencera son essor qu'au XIVème si je ne m'abuse) se tourneraient davantage vers le roi de France
que vers le Pape en cas de conflit à trancher ?
Développement de la justice royale : l'enquête et l'appel
Dans l'empire romain, le plaideur
mécontent pouvait appeler de la sentence d'un tribunal inférieur au gouverneur (praeses) de la province, ou encore du tribunal municipal au même personnage, du gouverneur au vicaire des Septem
provinciae ou desDecem provinciae, au préfet du prétoire des Gaules, enfin à l'empereur lui-même, qui décidait dans son conseil privé.
Tout ce monde disparût avec l'Empire,
mais le roi franc tint la place de l'empereur, et les Gallo-Romains purent interjeter appel à lui. Ainsi, chez les Francs, le plus ancien texte connu prévoit une procédure d'appel (article LVII
de la loi salique).
L'idée d'appel ressort aussi
clairement de divers capitulaires carolingiens (comme le capitulaire de 805). L'empereur carolingien était aidé dans la tâche consistant à rendre des sentences définitives par les missi
dominici.
A partir du Xe siècle, avec le
développement de la féodalité, la procédure d'appel tombe en désuétude et est remplacée de plus en plus par des jugements de Dieu (qui ont toujours existé, depuis les Mérovingiens, mais qui se
développent dans des proportions gigantesques à cette époque).
Le duel s'introduisit aussi dans des différends entre clercs ou un établissement ecclésiastiques et un noble. La partie cléricale ne pouvant combattre en personne se faisait représenter par un
champion, bénévole ou professionnel, et comme celui-ci n'avait pas droit aux armes nobles, l'adversaire laïque devait se faire remplacer par un champion n'usant lui aussi que des armes non
nobles, l'écu et le bâton.
Les procédures pouvant mener au duel
judiciaire sont le recours par faussement de jugement et le recours pour défaute de droit.
Le recours par faussement de jugement
a lieu lorsque le plaignant accuse le tribunal d'avoir violé la loi.
Le recours pour défaute de droit est
un recours contre un déni de justice. Il apparaît par exemple lorsque le seigneur justicier se refuse à constituer un tribunal pour ouïr la plainte d'un homme qui requiert jugement ou même se
laisse aller à maltraiter le plaignant ; idem si le seigneur tente de berner le plaignant, de le décourager, en différant indéfiniment son consentement ou en se déplaçant. Mais les constatations
de cette mauvaise volonté du seigneur doivent être établies dans les formes légales, parfois complexes, et fonction du statut du plaignant. Le procès porté devant le souverain, il faut prouver la
défaute par des témoins loyaux.
A l'époque de Saint Louis, une
véritable procédure d'appel reparaît, sous la forme de l'émende (emendatio) : suite à une plainte, un bailli royal est donc prié de constituer un autre tribunal ou le même tribunal une seconde
fois, pour trancher l'affaire. La jurisprudence distingue nettement entre l'émende et le véritable appel. En fait, l'avenir n'était pas à l'émende, mais à un appel transformé.
Pour comprendre les raisons qui ont
favorisé la pratique de l'appel, il faut se rappeler que pour l'homme médiéval, nul jugement n'est jamais définitif. Pour qu'il le devint, il fallait que les parties et leur parenté l'acceptent.
La réforme de l'appel s'est faite à la Cour du roi. Suite aux lettres des papes Innocent IV et Alexandre IV condamnant le duel judiciaire, Saint-Louis prend une mesure interdisant dans tout le
domaine royal (à défaut de mieux) cette pratique. Cette mesure est très mal reçue, et les possesseurs de fiefs pensent avoir perdu leur liberté, en étant soumis à l'enquête dans un différend
judiciaire.
La bataille judiciaire régresse
fortement sous le règne de Saint-Louis, pour reprendre en force partout (même à la Cour) sous le règne de son successeur. En 1306,
Philippe le Bel maintient
l'établissement de Saint Louis pour les causes civiles, mais autorise à nouveau le duel judiciaire en matière criminelle et capitale. A la fin du règne de Philippe le Bel, la féodalité reprend le
dessus et réussit à imposer à la royauté des chartes pour limiter ses prérogatives et défendre celles de la noblesse (par exemple, la charte aux Bourguignons, la charte aux Picards). Les duels et
les guerres privées sont alors en recrudescence partout. Les troubles de la Guerre de Cent Ans ne font que favoriser cette tendance. Il faut attendre la fin du règne de Charles V et même celui de
Charles VI pour assister à nouveau au recul du duel judiciaire.
Malgré tout, la nouvelle procédure
devait finir par triompher, et le germe déposé par Saint Louis, trop longtemps contrarié dans sa croissance, finit par éclore. Citons
Montesquieu :
Citation:
Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux de quelques grands seigneurs une manière de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la religion, à la
tranquillité publique, à la sûreté de la personne et des biens, on abandonna l'autre.
Notons que l'ancienne procédure ne disparut en aucune manière. Nos ancêtres répugnaient à faire disparaître quoi que ce fut du passé, si bien que la vie juridique, politique, administrative
s'encombra de déchets que l'on se refusa à éliminer jusqu'à la Révolution.
Le Parlement
A partir de 1250, des Parlements à
jours fixes sont annoncés à l'avance et quels que soient les déplacements du roi, la Cour de Justice cesse d'être ambulante et réside à Paris. En même temps apparaissent des espèces de
commissions judiciaires, composées de clercs et de chevaliers de l'Hôtel, sous la présidence d'un évêque ou d'un grand seigneur. Elles se réunissent selon les besoins (d'abord deux sessions
annuelles, puis une seule et longue session de la Toussaint au mois de mai, puis enfin une session occupant toute l'année). Le terme de parlement, utilisé jusqu'alors en France et en Angleterre
pour désigner une conférence quelconque, tend à se restreindre aux seules sessions judiciaires tenues par les spécialistes de ces sessions, que l'on commence à appeler, dès la fin du XIIIe
maîtres tenant le parlement. Toutefois, ces maîtres ne sont pas confinés dans leurs attributions judiciaires, et on les retrouve encore au Conseil et aux Comptes.
Le changement de procédure introduit
par Saint Louis joue un rôle capital dans la transformation du tribunal du roi en un véritable tribunal d'appel. L'appel exige une enquête, et l'enquête devient le pivot du procès, quasiment le
procès lui-même. Vers 1291 apparaît une commission de deux maîtres clercs et de deux maîtres lais, embryon de la Chambre des Enquêtes. Ce nombre est porté à 8 en 1307, à 57 en 1336, réduit à 40
en 1345. En somme, le Parlement de Pris existe donc virtuellement à la fin du règne de Philippe le Bel, à la place des parlements des règnes précédents, mais il est encore à demi engagé dans la
gangue du passé.
Outre la Chambre des enquêtes, on
trouve la Grand Chambre où l'on plaide et où l'on rend les arrêts sur les plaidoiries. Ces arrêts mettent fin à des contestations de natures très diverses : différends entre grands personnages
ecclésiastiques ou laïques, entre communes et baillis, etc. La Grand Chambre transforme en arrêts les jugés de la Chambre des Enquêtes. La preuve par duel n'a pas disparu, mais elle régresse
fortement, si bien qu'il est peu d'affaires qui puissent être résolues sans avoir recours à l'enquête. D'où la nécessité de commissaires, appelés auditeurs, chargés d'aller entendre sur place des
témoins. Les enquêtes terminées, il convient d'en apprécier la valeur. C'est aussi l'affaire de la Grand Chambre. Si elle estime l'affaire bien conduite, elle envoie celle-ci à la Chambre des
Enquêtes ou à l'auditoire de droit écrit pour qu'elle soit jugée. Ceci fait, les causes lui reviennent pour être transformées par elle en arrêts. La Grand Chambre retient pour elle-même
:
les enquêtes de sang
les enquêtes criminelles qui ne sont pas de sang mais qui entraînent une perte corporelle
les causses civiles concernant grièves causes telles que honneur de corps ou héritage, ou grande personne et grands hommes
Le jugement de la Grand Chambre est
définitif.
A partir de 1296, Philippe le Bel
constitue vraiment une autre chambre, la Chambre des Requêtes, destinée à ouïr les requêtes et à commander les lettres de justice qu'entraîent celles-ci. Cette chambre ne s'occupe que des
affaires à régler d'après le droit coutumier, les requêtes du Midi étant l'affaire de l'auditoire de droit écrit.
Le Châtelet
Au XIVe siècle, Paris et sa banlieue
sont administrés par un personnage nommé prévôt, ou plus exactement garde de la prévôté de Paris. Il administre et juge en premier ressort les sujets du roi à Paris, mais il reçoit aussi en appel
les sentences des petites prévôtés royales de la vicomté, comme celles des nombreuses seigneuries existant à Paris même, dans sa banlieue, et dans la vicomté. Ce garde de la prévôté joue donc le
rôle d'un bailli et, sous une appellation plus modeste, est plus important que les baillis.
Il a sans doute fallu très longtemps
pour que le prévôt de Paris parvienne à cette éminente situation. Au XIe et au XIIe siècles, il ne semble pas différent des autres prévôts. Il a comme eux la perception des débris de droits
régaliens, de droits féodaux et censuels, conservés par la royauté. Celle-ci lui confie également l'exploitation des droits administratifs, judiciaires, financiers, et la royauté afferme la
prévôté pour la durée d'un an (à Paris, deux personnages s'unissent parfois pour affermer la prévôté).
Dès le début du règne de Philippe
Auguste, on superpose des baillis aux prévôts, et rien n'eut été plus simple que d'instituer un bailli de Paris et du Parisis. Mais la nouvelle institution des baillis demeura quelque temps
flottante, et les baillis, encore membres de la Cour du roi, n'offraient pas les garanties pécuniaires nécessaires pour la perception des revenus domaniaux.
Le prévôt de Paris acquis donc
rapidement une grande autorité sur une zone territoriale très étendue.
Le pouvoir du prévôt devait avoir un
siège fixe. Si haut que nous remontons, on le trouve établi non à l'intérieur de la Cité, mais à la tête du pont qui, de toute antiquité, reliait l'île à la rive droite. Là s'élevait une
forteresse, le Châtelet, déjà puissant au Xe siècle, et qui défendait l'entrée de Paris, tant que la ville tint tout entière dans la Cité.
Le prévôt de Paris, puissant
personnage accablé d'occupations, a besoin d'être aidé, et se choisit donc deux lieutenants, l'un pour les causes civiles, l'autre pour les causes criminelles. Pour rendre la justice, le prévôt
est tenu d'avoir des conseillers, qui portent le nom d'auditeurs et ont pour tâche d'écouter les témoins qui déposent à l'instruction. Initialement, le prévôt n'avait pas un personnel déterminé
et prenait comme auditeurs qui il voulait pour chaque affaire. Au début du XIVe, il n'y a que deux auditeurs, mais leur fonction est devenue stable. Ils siègent dans la Chambre du Tribunal du
Châtelet. On voit apparaître à côté des auditeurs (qui interrogeaient sur place les témoins) des examinateurs, qui se déplacent à la recherche des témoins. De plus, si au criminel le ministère de
procureurs et d'avocats est inutile, il est d'un emploi indispensable et fréquent au civil : le nombre de procureurs se mutliplie au cours des XIVe et XVe siècles. Tout avocat inscrit au
Parlement peut plaider au Châtelet. Le roi veillait à ses intérêts au sein du Châtelet par l'intermédiaire de son procureur et de deux avocats. Les notaires sont chargés d'écrire toutes les
pièces concernant les affaires en instance. Il faut encore ajouter à tout ce beau monde les sergents, qui sont les agents d'exécution des sentences, et les gardiens de la sécurité publique : ils
font les sommations, procèdent aux saisies, font la police des rues. Au criminel, ils arrêtent les inculpés, et en cas de condamnation, assistent à l'exécution.
Le Châtelet s'efforçait donc d'imiter
le Parlement, mais c'était un Parlement mal organisé, mal composé, mal dirigé. C'était plutôt un foyer d'abus de toutes espèces. La tenue de la maison était déplorable ; les affaires étaient
traitées dans un bruit assourdissant. Les procureurs, et surtout les jeunes clercs empêchaient d'entendre les avocats ; les procureurs interpellaient les avocats et s'en prenaient même aux
juges.it, multipliant défauts, renvois, écritures de toutes sortes, jusque dans les causes minimes. Quant aux ordonnances royalmes multipliées, on n'en tenait aucun compte. Le Parlement avait la
haute main sur le Châtelet, mais pour être efficace, la surveillance aurait dû être constante, ce qui n'était pas possible, le Parlement étant accablé d'affaires venues de tous les points de la
France.